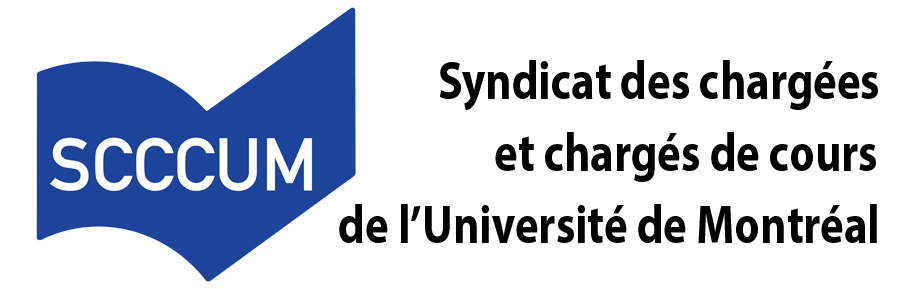Michaël Séguin, v.p. aux relations intersyndicales
Que vise-t-on par l’internationalisation de l’enseignement supérieur ? À promouvoir la coopération interculturelle et l’élargissement de l’horizon intellectuel de nos étudiants ou à augmenter la place des universités de prestige dans les palmarès internationaux et à remplir leurs coffres en attirant davantage d’étudiants étrangers ? Bref retour sur la question à partir du Congrès des Amériques sur l’éducation internationale.
Se tenait, du 11 au 13 octobre dernier au Palais des congrès, le Congrès des Amériques sur l’éducation internationale. Dépêché sur les lieux par l’exécutif du SCCCUM pour mieux saisir le discours entourant ce congrès parrainé par Concordia, l’ÉTS, McGill, l’UQAM et l’UdeM, il ne m’a pas fallu longtemps pour constater que je n’étais pas dans un congrès académique ordinaire, car presque tous les hommes étaient en complet-cravate et les femmes en tailleur. La salle du Palais des congrès était d’ailleurs configurée comme si un banquet allait s’y dérouler, avec ses tables rondes sur lesquelles on avait posé des fleurs et avec en arrière plan une douce musique d’ascenseur (du jazz). Une fois l’activité lancée, il m’est apparu clairement que je n’étais pas dans un colloque scientifique, mais dans une grande foire visant à promouvoir l’internationalisation des universités, un espace où nouer des partenariats d’enseignement et de recherche, où discuter de politiques universitaires d’inclusion de la diversité, tout comme un lieu pour débattre des problèmes qu’amène l’internationalisation. S’y côtoyaient d’ailleurs politiciens, administrateurs universitaires, professeurs, agents de promotion universitaires et représentants des entreprises à caractère académique (Altissia, Mitacs, QS Rankings, etc.).
C’est probablement ce caractère hybride, croisant la marchandisation et la critique de la marchandisation, qui rendait cet événement des plus intéressants. Après tout, ce congrès faisait se croiser tant Andreas Weichert, de la division de l’éducation internationale d’Affaires mondiales Canada, qu’Hans de Wit, le directeur du Center for International Higher Education du Boston College, une sommité sur la question. Il vaut la peine de résumer rapidement leurs présentations.
Weichert nous a longuement vanté les mérites de l’internationalisation à l’aide des indicateurs canadiens : 325 000 étudiants étrangers en 2014 créant 123 000 emplois, pour des revenus de 11,4 milliards de dollars. C’est donc dire que derrière les étudiants étrangers, et en particulier derrière la vente de services éducatifs, il y a beaucoup de profits à faire. Weichert n’a d’ailleurs pas manqué de nous expliquer que son unité était responsable du branding de l’éducation supérieure canadienne à l’étranger, de coordonner les échanges entre les institutions canadiennes et étrangères, de faire entendre les intérêts canadiens auprès des institutions internationales et d’attirer des cerveaux au moyen de bourses internationales. Son discours se résume à peu près à ceci : le Canada est un pays où il fait bon vivre, il est reconnu pour l’excellence de son éducation, il est un meneur en innovation depuis au moins 150 ans et nos universités se classent bien dans les palmarès internationaux.
De Wit, de son côté, a mentionné d’entrée de jeu que si les idéaux à l’origine de l’internationalisation étaient nobles, celle-ci s’est développée d’une manière assez problématique ces dernières années : à la tendance à la privatisation, à concevoir l’éducation comme une façon de générer des revenus, s’ajoutent les activités de toute une industrie des services éducations (agences de placement, assurances, services linguistiques, etc.) qui l’éloignent de sa visée de coopération. S’y mêlent ensuite les palmarès (QS, Times Higher Education, etc.), puisque l’internationalisation devient une manière d’agir sur eux. Les trois indicateurs que sont l’échange d’étudiants, l’échange de profs et les publications interinstitutions participent désormais à une logique de compétition et d’alliance stratégiques qui était bien moins prégnante il y a 20 ans. Selon De Wit, cela engendre une obsession des nombres au profit de la qualité : on ne mène plus l’internationalisation pour enrichir la formation des étudiants, mais pour grossir les « exportations ». Selon lui, il faut que la préoccupation pour l’expérience étrangère soit intégrée au curriculum et ne se contente pas d’être du tourisme académique ; il faut une cohérence entre ce qui est enseigné et le besoin d’en poursuivre l’étude dans une institution étrangère. L’internationalisation doit répondre à un besoin éducatif, et non pas être menée seulement par des intérêts économiques des universités et des États.
Tout cela fait évidemment se poser une question : où en sommes-nous à l’UdeM ? Sur 45 000 étudiants, 5 000 viennent de l’étranger. Notre université a aussi conclu 600 ententes internationales dans une cinquantaine de pays. J’ai appris en discutant avec trois professionnelles de la direction des Affaires internationales (http://international.umontreal.ca/) que non seulement 14 salariés travaillent dans cette section, mais que les fonds qu’ils gèrent ne sont destinés qu’aux professeurs (surprise !). Par exemple, si un professeur part en voyage d’études dans une université partenaire, il peut obtenir un financement allant jusqu’à 1 200 $ par étudiant et voir son voyage entièrement payé. Un chargé de cours ne peut faire une telle demande, mais s’il passe par un professeur qui le met sur sa demande, il peut après coup être compensé pour accompagner le voyage, si le prof le veut bien ! Sur cette question aussi, nous avons bien du travail à faire, non seulement pour que nous puissions être intégrés au processus d’internationalisation, mais aussi pour que cette internationalisation soit autre chose qu’une course aux étudiants étrangers !