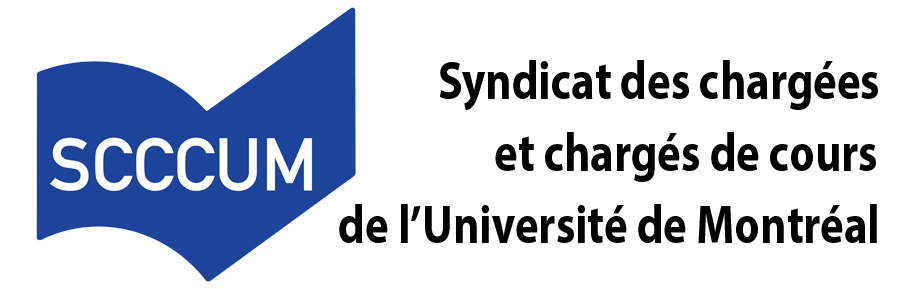Peut-être que c’est l’époque qui
veut cela, mais on tombe des nues en constatant que la Journée internationale
de lutte pour les droits des femmes s’est transformée, au fil du temps et pour
beaucoup, en « Journée de la femme »[1]
que l’on souhaite à tout une chacune, comme la Saint-Valentin, le fête des
grands-mères ou les poissons d’avril. Cette dérive est d’autant plus
préoccupante que la lutte pour les droits des femmes est loin d’être aboutie,
partout dans le monde et dans de multiples domaines. Le présent texte se penche
sur la sous-représentation des femmes dans les sciences, de même qu’à ses
causes et conséquences possibles.
Un premier constat : les femmes occupent une place croissante, mais toujours marginale dans les sciences « dures » au Québec, ainsi qu’en génie et en informatique.
Pour se donner une idée documentée du phénomène, voici quelques statistiques concernant le pourcentage de femmes parmi les professeurs-chercheurs du Québec en sciences appliquées et en sciences pures :
| 1999-2000 | 2006-2007 | 2010 | |
| Sciences appliquées | 10.5% | 14.5% | 16.1% |
| Sciences pures | 13.1% | 17.5% | 20.1% |
Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
On peut également se référer aux statistiques du rapport « Progression des femmes en sciences au Québec – 2004/2011 », publié par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, qui indique que de 2004 à 2011, le pourcentage de professeures-chercheuses en sciences pures et appliquées est passé de 15.8 à 17.6 (une faible progression pour un faible pourcentage), tandis que le pourcentage de diplômées a reculé de 0.6 point pour passer de 34.3 % en 2004 à 33.7% en 2011.
Pour sa part, l’Ordre des Ingénieurs du Québec (rapport annuel 2016-2017) constate que – bien qu’en progression – le nombre de ses membres féminins reste encore faible, lui aussi : 14.3% en 2016-2017, contre 14% en 2015-2016.
Un deuxième constat : le financement par le Canada des recherches menées par des femmes est proportionnellement moindre que celui des recherches menées par des hommes, en particulier quand l’examen de la demande de subvention porte sur la personne responsable du projet plutôt que le projet lui-même.
Il en va ainsi des recherches en santé, écrit Sheryl Ubelacker : « lorsque les évaluations reposaient principalement sur le leadership et l’expertise du chercheur principal, l’écart entre les sexes était de quatre points de pourcentage, les hommes profitant de meilleurs résultats que les femmes dans l’obtention de subventions pour leurs recherches »[2]. Quatre points de pourcentage, cela peut sembler négligeable, mais il ne faut pas oublier que seuls 16% des projets sont subventionnés, et qu’il s’agit du domaine de la santé, où les femmes sont mieux représentées qu’en informatique, en génie ou en mathématiques. Ian Bussières écrit quant à lui – en 2019 – que « selon l’Institut de recherche en santé du Canada, qui a analysé 24 000 demandes de subvention en cinq ans, 15 % des demandes présentées par des hommes ont été acceptées contre seulement 9 % pour celles déposées par des femmes »[3].
Comme si cela ne suffisait pas, Adrian Mota, de l’Institut de recherche en santé du Canada, indique qu’en plus, les enseignantes-chercheuses ont tendance à demander des subventions moins importantes et de plus courte durée que leurs homologues masculins[4]. Convenons qu’il est délicat de généraliser les chiffres concernant le domaine de la santé à l’ensemble des sciences exactes, mais on peut raisonnablement envisager que le pourcentage de subventions accordées aux enseignantes-chercheuses est encore moindre dans les autres disciplines dont il est question dans ce texte.
Il y a donc bien quelque chose de pourri au Royaume des sciences : étudiantes moins nombreuses, enseignantes-chercheuses ultra-minoritaires dans certaines unités et subventions moindres. On pourrait vouloir se rassurer en se disant que d’une part cette sous-représentation des femmes n’est pas le fait de notre seul état, puisque la fiche d’information No51 de l’Institut de Statistiques de l’UNESCO indique que le reste du Canada, les États-Unis, la France, l’Allemagne (pour ne citer que ces pays), ne font pas mieux en matière d’égalité et d’équité hommes/femmes[5]. On pourrait aussi se dire que ces disparités n’ont pas de conséquences fâcheuses sur la société et que, les femmes ayant accès à des domaines d’emploi plus étendus et plus rémunérateurs qu’auparavant, ce que l’on constate est en fait une répartition « naturelle » des talents et des orientations masculines et féminines à laquelle « on ne peut rien ». Ou, plutôt, l’on pourrait être réaliste et se dire que cet état de fait est le résultat de contraintes culturelles plus ou moins conscientes et qu’il a bien des conséquences funestes pour la société.
Les origines de la désaffection des femmes pour les métiers des sciences « dures »
Si l’on en croit Thomas Breda[6], la cause principale du déséquilibre homme/femme dans les sciences dures et appliquées n’est pas la discrimination (Breda, 2014 : p. 103). Ce n’est pas non plus un problème « d’aptitude » cognitive ou intellectuelle (Breda, 2014 : p.103) ; pas plus qu’une question de « compétence innée » plus fréquente chez les hommes (c’est-à-dire la croyance selon laquelle la proportion de « génies » serait plus importante chez les premiers).
Ce serait plutôt, comme trop souvent, « les stéréotypes, les normes sociales et les choix d’éducation qui seraient en cause » (Breda, 2014 : p. 108). Bien que nombreuses, voire majoritaires, dans certaines filières, les étudiantes ne choisiraient pas au final les métiers afférents à leur discipline, comme en informatique, par exemple. L’image foncièrement masculine de l’emploi (directeur de laboratoire, enseignant-chercheur) rebuterait les femmes et les découragerait de tenter l’aventure dans une voie qu’elle devrait pouvoir emprunter de plain-pied. Cette image est faite de couches superposées de croyances et de représentations, certaines véhiculées par la famille ou l’école (« les garçons sont meilleurs en math, les filles en français »), d’autres par les médias, d’autres encore par les institutions elles-mêmes : combien de Donna Strickland face à Albert Einstein et ses doubles dans l’histoire de la physique? Et quelle est leur visibilité?
Plus catégoriquement, c’est dans l’université et l’institut de recherche eux-mêmes que le stéréotype institutionnel se fige et exclut le féminin : le ratio enseignantes/enseignants est de 1/10 en moyenne, ce qui signifie que, parfois pendant plusieurs années, les étudiantes en mathématiques, en chimie, en physique, en informatique, en ingénierie, ne voient au pupitre de professeure ou à la direction de travaux de laboratoire aucune enseignante susceptible de devenir leur mentor. Or, souligne Breda :
Une méthode qui a prouvé son efficacité est de faire intervenir ce qu’on appelle en économie des « rôles modèles ». Il s’agit de faire interagir les étudiantes avec des scientifiques femmes à qui elles peuvent s’identifier. Ces politiques simples semblent extrêmement efficaces. De nombreuses recherches montrent ainsi qu’avoir une femme comme professeur dans les matières scientifiques améliore à la fois le niveau des étudiantes dans ces matières et leur probabilité de poursuivre des études scientifiques (Canes & Rosen, 1995 ; Rothstein, 1999 ; Gardecki & Neumark, 1998 ; Bettinger & Long, 2005 ; Hoffman & Oreopoulos, 2009 ; Carrell et al., 2010).
Dans cette perspective, on comprend bien l’urgence qu’il y a non seulement à favoriser l’embauche de femmes aux postes d’enseignantes-chercheuses, mais aussi à s’assurer que leurs demandes de subvention soient traitées équitablement, afin que ces femmes puissent jouer pleinement le rôle de mentor et de modèle auprès de leurs étudiants-es (rien ne dit qu’il ne soit pas utile et souhaitable que les hommes étudiant en sciences dures aient de nombreux modèles autres que masculins).
Conséquences de la désaffection des femmes pour les filières des sciences « dures ».
Aux sceptiques qui penseraient que cette égalité et cette équité n’auraient pas de conséquences importantes sur la société en général, voici quelques considérations à prendre en compte pour éviter les jugements hâtifs.
D’abord, la relative rareté des femmes à la tête des recherches scientifiques que ce soit en informatique, en génie civil ou militaire, ou même en santé peut mener, et mène probablement à des biais importants. Ian Bussières, du Soleil[7], rappelle ainsi que les premières ceintures de sécurité, mises au point et testées par des hommes, ne correspondaient pas à l’anatomie féminine et qu’en conséquence ne procuraient pas à ces dernières la même protection qu’aux hommes.
Ensuite, comme le souligne Thomas Breda (Breda, 2014 : 101), la situation globalement moins bonne des femmes sur le marché du travail est en partie liée à cette ségrégation originelle : les filières scientifiques mènent en général à de meilleurs salaires et, forcément, les revenus moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes dans la population, ce qui a toutes sortes d’incidences, notamment sur leur autonomie financière. Mais cela va plus loin encore : Breda souligne qu’en France les filières de sciences « dures » mènent aux grandes écoles, comme la fameuse Polytechnique, mais aussi l’École Centrale, l’École des Mines, etc. Cela signifie, en clair, que ces filières, menant aux plus hauts postes décisionnels, aux postes à plus forte responsabilité, sont donc très majoritairement détenus par des hommes. En va-t-il différemment au Québec et au Canada?
Le présent article ajoute donc à une somme déjà importante de textes sur ce sujet en provenance du Québec, du Canada, de France, d’Allemagne ou d’ailleurs. Le problème est connu, ses conséquences de mieux en mieux documentées ; les politiques publiques tentent d’établir un équilibre qui n’a jamais existé auparavant, et tout le monde ou presque est d’accord pour dire qu’il faut remédier à la situation. Qu’en est-il ici à l’Université de Montréal? Que faire quand les textes et les politiques s’accumulent tandis que la situation s’aggrave, comme ce fut le cas pour la diplomation d’étudiantes dans les filières scientifiques entre 2004 et 2011?[8]
Gwenn Scheppler
[1] Pour se convaincre de cette dérive, voir le blog « Big Browser », à la date du 7 mars 2018, dans Lemonde.fr : https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2018/03/07/ne-nous-souhaitez-pas-une-bonne-fete-de-la-femme_5267205_4832693.html
[2] Sheryl Ubelacker, « Les femmes scientifiques obtiennent moins de subventions, selon une étude », La Presse canadienne, 7 février 2019. À noter, l’auteur de ce texte n’a pas réussi à vérifier les chiffres avancés dans l’article sus-cité.
[3] Ian Bussières, « Les filles, toujours moins nombreuses en sciences », Le Soleil, 23 février 2019 : https://www.latribune.ca/actualites/science/les-filles-toujours-moins-nombreuses-en-sciences-065bfe9289266f02aa3be5047c3f2387
[4] Selon Sheryl Ubelacker, même source que précédemment.
[5] http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs51-women-in-science-2018-fr.pdf
[6] Thomas Breda, « 5. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes en science ? », Regards croisés sur l’économie, vol. 15, no. 2, 2014, pp. 99-116.
[7] Ian Bussières, « Les filles, toujours moins nombreuses en sciences », Le Soleil, 23 février 2019 : https://www.latribune.ca/actualites/science/les-filles-toujours-moins-nombreuses-en-sciences-065bfe9289266f02aa3be5047c3f2387
[8] Progression des femmes en sciences au Québec : https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/etudes_statistiques/innovation/progression_femmes_sciences_quebec_2004-2011.pdf